13/02/2022
Ca ferme !
Pour un fan des petits maîtres de la peinture du XIX° siècle comme moi, l'exposition au musée du Havre était à voir absolument. Et je n'ai vraiment pas été déçu.
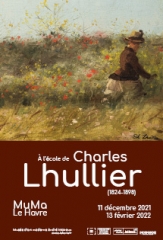
Si Charles Lhullier (1824 - 1898 ) a laissé une petite trace dans l'histoire de l'art, ce n'est pas pour son œuvre mais par les élèves qu'il a eu à l'école des BA du Havre qu'il a réorganisée et dynamisée. La vingtaine de toiles réunies par le musée André Malraux venant essentiellement de ses réserves mais aussi d'autres musées normands et de collections privées montre un artiste avec une solide formation classique. Si les quelques grands formats présentés (Le café des Turcos, Un ordre) souffrent d'un manque total d'audace que ce soit dans la composition comme dans le style, Lhullier se montre bien plus personnel et touchant dans des portraits familiaux ou dans des petits formats de paysages habités de rares silhouettes humaines (A Bléville, Paysage des environs d'Honfleur ou Silhouette de femme cueillant des fleurs dans un champ). Un artiste dont il y a sans doute encore beaucoup à découvrir.
Comme enseignant, Lhullier dut savoir se montrer assez libre et pédagogue car on trouve parmi ses élèves aussi bien un peintre animalier au style très classique comme Georges Frédéric Rötig (représenté par le superbe Lion et lionne à l'affut et des Études de chiens) que des chantres de l'art moderne comme Raoul Dufy et Othon Friesz ; des artistes célébrés en leur temps comme d'autres restés simple amateurs (même doués). On admire ainsi autant un charmant et bucolique Tombeau fleuri au prieuré de Granville de Georges Binet que les scènes de vie modernes La carrière ou La manifestation de Maurice Émile Vieillard ; les lumineuses Barques de pêches de René de Saint-Delis comme le Bassin du commerce au Havre enneigé de Albert Roussat ; l'attelage de chevaux ployant sous L'effort de Raymond Lecourt comme les gens profitant dans un parc de la Détente Hebdomadaire (Vaugirard) de Gaston Prunier... Plein de belles découvertes !
A l'école de Charles Lhullier, musée d'art moderne André Malraux, Le Havre, jusqu'au 13 février.
11:41 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)
16/01/2022
Dans l'atelier de Roybet
Si l'exposition Dans l'atelier de Ferdinand Roybet n'est qu'une exposition dossier sur deux petites salles (accompagnée de changements dans l'accrochage des autres salles), elle permet néanmoins aux habitués du musée de Courbevoie de se faire une idée un peu plus précise, en présentant des peintures et dessins que je n'y avais jamais vu accrochés jusqu'ici, d'un artiste célèbre en son temps dont on se prend à rêver d'une grande rétrospective un jour.
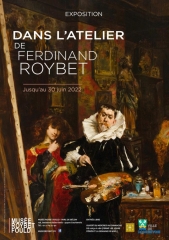
On découvre ainsi des œuvres de ses années de formation à Lyon (Le petit savoyard, La jeune fermière), de son séjour en Algérie (Femme d'orient dans son intérieur et plusieurs dessins), un somptueux Gentilhomme à la cape verte et à la rapière (portrait du graveur Charles Waltner), des gravures et un bel ensemble dessins où Roybet se montre grand dessinateur aussi bien au fusain (très beau Portrait d'homme), à la pierre noire (Charles Waltner), au crayon graphite (Le joueur d'échecs) qu'au lavis (Scène de joueur, Luthier sans son atelier).
Dans les autres salles, parmi les œuvres que je n'avais jamais vu dans mes passages précédents au musée, on note un Courbevoie pendant les inondations de 1910 de Auguste Durst, artiste grandement oublié sur lequel on en découvrira plus ici, un curieux Retour des cendres de Napoléon Ier à Courbevoie par François Fortuné Antoine Ferogio, la très symboliste Semeuse d'étoiles de Consuelo Fould ou le Masque mortuaire de Carpeaux par Jean Marie Rollion. Comme toujours une visite au musée Roybet-Fould de Courbevoie est une grande source de découvertes...
Dans l'atelier de Ferdinand Roybet, Courbevoie, musée Roybet-Fould, jusqu'au 30 juin 2022.
13:43 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)
31/12/2021
Les réserves de nos musées ont du talent
L'un dans l'Eure, l'autre dans l'Oise, deux de nos "petits" musées de province / banlieue présentent des expositions avec des œuvres sorties de leurs réserves. Et ce sont de grandes réussites.
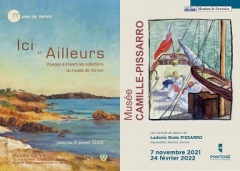
Le musée de Vernon nous présente donc des paysages d'"ici" confrontés à des œuvres d'"ailleurs" (armes venues d'Afrique, gravure d'objets asiatiques). Si certaines œuvres ont déjà été vues car parfois accrochées aux cimaises des collections permanentes (l'étonnante Marine de Charles Lacoste, le très beau Paysage à marée basse de Karl Daubigny ou la magnifique Route dans la montagne de Rosa Bonheur) d'autres sont pour moi inédites. Une série de petites esquisses sur le mont St Michel de Louise-Denise Damasse, des aquarelles à la composition originale de Arthur Bourdillat et Roger Reboussin, une Montagne de Paul Jouve surtout connu comme peintre animalier, une Tête d'homme de l'orientaliste Eugene Girardet ou une charmante petite huile Sur la plage en Bretagne de Adolphe Ernest Gumery... Et l'exposition est surtout l'occasion de voir une grosse partie des fonds Georges Paul Leroux et Paul Jouanny que possède le musée (qui présente souvent une ou deux œuvres de chaque artiste). Célèbre comme décorateur de son vivant, le premier se montre un paysagiste sensible et ses vues de carrières sont étonnantes. Très méconnu mais présent régulièrement ces derrières années dans les expositions sur les vues de la Seine, le deuxième est un paysagiste qui mérite vraiment d'être redécouvert aussi bien pour ses vues d'Île-de-France que du sud de la France.
Le musée de Pontoise a lui sorti de ses réserves les carnets de Ludovic-Rodo Pissarro le quatrième fils de Camille Pissaro. Certains sont présentés dans des vitrines tandis que les murs sont ornés de différentes aquarelles. Vues de Bretagne, de Normandie, de Paris, de Pontoise, du sud de la France, d'Angleterre mais aussi croquis des élégantes et de la vie parisienne, caricatures familiales... les thèmes sont aussi variés que les techniques (crayon, encre, aquarelle...). Rodo fait preuve d'une grande sensibilité pour saisir le pittoresque de la ville ou le calme de la nature ainsi que d'un sens aigu pour croquer les travers de la société (et de ses proches). Une magnifique découverte qui donne envie d'en savoir plus sur un des moins connus des fils Pissaro. Si le catalogue est très bien illustré (on peut voir notamment d'autres dessins de certains carnets), il est malheureusement très pauvre en essais...
Ici et ailleurs, voyages à travers les collections du musée de Vernon, musée de Vernon, jusqu’au 9 janvier 2022
Les Carnets de dessin de Ludovic-Rodo Pissarro, musée Pissaro, Pontoise, jusqu'au 24 février 2022
18:45 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)
13/11/2021
Tous à Orléans !
Si les somptueuses collections du musée des BA d’Orléans n’étaient pas une raison suffisante pour avoir envie de s’y rendre (en plus le nouveau parcours du XIX° siècle est désormais présenté – et il est magnifique-), ce n’est pas une mais trois expositions qui vous y attendent pour quelques jours encore.
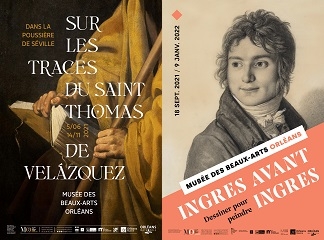
Première à avoir ouverte, l’exposition consacrée au Saint Thomas de Velázquez, une des pièces majeures du musée, est bien plus qu’une simple exposition dossier. Entre la redécouverte de la peinture espagnole à la fin du XIX°, les radiographies de différentes œuvres de Velázquez pour comprendre sa technique, des peintures de son maître Pacheco, des gravures d’Apostolado (ensemble de douze à quatorze tableaux de figures isolées représentant le collège apostolique ) complets (en particulier de Callot) et une bonne dizaine d’apôtres représentés à mi-corps d’artistes comme Luis Tristan, Daniel Seghers, Ribera, Pacheco et bien sûr Velázquez, on comprend toutes les difficultés qu’il y a à attribuer des œuvres quand les nouvelles influences naturalistes et les nouveaux modèles passent d’un atelier à un autre, et d’essayer de réunir les œuvres de l’éventuel Apostalado de Velázquez dont proviendrait le Saint Thomas. L’ajout d’un dernier tableau à la dernière minute d’une qualité trop faible pour être entièrement autographe mais avec suffisamment de points de rapprochement pour penser qu’il pourrait sortir de l’atelier et appartenir à la série rajoute encore de l’intérêt à cette passionnante enquête loin d’avoir révélée tous ses secrets.
Tout aussi passionnante, l’exposition Ingres avant Ingres s’intéresse à la jeunesse du maître montalbanais depuis sa première formation chez son père jusqu’au prix de Rome en 1801 (Achille recevant les envoyés d'Agamemnon présent dans l’exposition) en passant par l’académie des BA de Toulouse et l’atelier de David, et cela à travers ses dessins quasi exclusivement. On y découvre comment il va progressivement créer son style de portraits dessinés d’abord à la manière de son père puis influencé par la manière de Jean Baptiste Isabey alors très à la mode avant de mettre en place son propre style. Comment il copie la sculpture antique ou les peintres anciens. Comment il croque rapidement des gens en pleine activité superbe et étonnante série). Comment à partir des leçons de David il met en place ses propres compositions de scènes historiques. Une plongée fascinante dans la formation d'un des plus grands peintres de l'histoire.
Enfin les trois cabinets d'arts graphiques présentent des dessins, gravures, pastels... consacrés à la nature : aux deuxième étage, fleurs et fruits ; au premier les animaux sauvages ou de la ferme et enfin au RdC les animaux domestiques. Dans la première section on admirera entre autres des études de fleurs de Jean Pillement (qu'on connait plus pour ses paysages) et Gérard van Spaendonck, une gouache avec un bouquet champêtre du lorrain Nicolas Pérignon et un très beau pastel de fleurs de bois de Rosalie Thévenin ; dans la deuxième, surtout riche en gravures, une superbe Scène pastorale de Jean Jacques Le Barbier, des Chèvres attribués à Jan II Kobell ou Quatre lionnes de Luis Félix Delarue ; enfin dans la dernière, outre de très belles œuvres de Géricault, Fromentin, Gérard ou Cogniet, un curieux Jeux d'enfants de Norblin de la Gourdaine avec son traineau tiré par des chiens et un amusant Chienne allongée sur un divan par le magistrat et poète Paul Besnard qui détourne les codes du nu féminin. C'est toujours un immense plaisir de découvrir les riches fonds d'arts graphiques des musées !
Dans la poussière de Séville... sur les traces du Saint Thomas de Velázquez, jusqu’au 14 novembre 2021
Ingres avant Ingres - dessiner pour peindre, jusqu’au 8 janvier 2022
La Nature imagée par les arts graphiques, jusqu’au 13 novembre 2021
10:37 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)
27/06/2021
Lucien Jonas à Soissons
Élève de Bonnat et Maignan, deuxième prix de Rome en 1905, peintre des armées pendant la première guerre mondiale, décorateur actif, Lucien Jonas fait partie de ces artistes de la première moitié du XX° siècle encore attachés à la tradition et actuellement en grande partie oubliés, qu'on a la chance de découvrir en parcourant les musées de province. Le musée de Soissons a choisi de lui rendre hommage en présentant, autour des quatre toiles monumentales acquises par la ville et provenant de l'Hôtel de la Croix d'Or, un bel ensemble d’œuvres provenant essentiellement des années 20 autour de certaines des facettes de l'artiste.
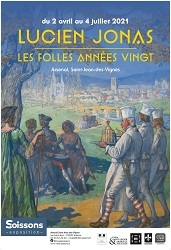
On avait déjà vu Lucien Jonas portraitiste, vigoureux et parfois presque caricatural, on est heureux de voir enfin ses œuvres du monde ouvrier, en particulier minier (il était natif d'Anzin, ville connue pour ses hauts fourneaux), naturalistes sans être misérabilistes, pleines d'affection. On le découvre peintre des vacances en bords de mer avec des représentations familiales pleines de tendresse et de lumière mais aussi peintre de la comédie française. Et on admire les quatre grands panneaux pour l'Hôtel de la Croix d'Or, truculents et lumineux, évoquant une certaine idée du XVIII°, ainsi que les nombreuses (et brillantes, quel merveilleux dessinateur au fusain !) études pour ce décor et quelques autres.
Bref une exposition très réussie qui n'a pas prétention à être une grande rétrospective mais nous permet de découvrir plusieurs visages de cet excellent artiste que l'on essaiera d'aller découvrir un peu plus en se rendant au centre minier de Lewarde qui lui consacre une autre manifestation.
Lucien Jonas - Les folles années 20, Arsenal Saint Jean des Vignes, Soissons, jusqu'au 04 juillet 2021.
13:57 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)
20/07/2020
Dreux-Maurice de Vlaminck
Première exposition faire après le confinement, il y a de cela quelques semaines déjà, le musée de Dreux ayant été un des premiers à rouvrir, Vlaminck le tumulte de la matière aura d'abord été l'occasion de découvrir une ville que je ne connaissais pas et un musée aux collections très intéressantes.
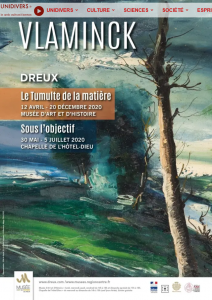
Je me suis longtemps peu voire pas intéressé à Maurice de Vlaminck. Jusqu'à ce que je découvre qu'après sa période fauve, généralement la plus appréciée et la plus montrée, il a évolué, en particulier sous l'influence de Cézanne, vers un style moins moderne mais beaucoup plus à mon goût. Or l'exposition de Dreux, loin d'être une rétrospective (il n'y a déjà qu'une vingtaine d’œuvres), se concentre sur ses peintures à partir des années 20 (une seule nature morte de sa période fauve) autour de la sublime Baie des Trépassés du musée avec des tableaux prêtés par sa famille.
Et à part un autoportrait et trois natures mortes, ce sont donc des paysages que l'on peut admirer : fermes, champs, villages ou forêts, parfois sous la neige, nous montrent une nature puissante, froide et souvent hostile. A la tonalité sombre des arbres, ciels et herbes répondent souvent les couleurs vives et violentes des blés ou d'un toit. C'est à une vision d'une ruralité en train de disparaitre et que Vlaminck est allé cherché en s'installant au fond de l'Eure-et-loir que nous assistons, une ruralité laissant place, sans aucun doute à regret pour le peintre, à une modernité industrielle montrée dans les trois derniers tableaux de l'exposition ou station essence, silo et véhicules motorisés envahissent désormais l'espace.
Un exposition petite mais qui mérite vraiment qu'on s'y rende.
Vlaminck, le tumulte de la matière, musée de Dreux, jusqu'au 21 mars 2021
10:54 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)
16/10/2016
En balade à Marseille...
... je ne me suis pas contenté de rendre visite au Vieux-Port et à la Canebière mais je me suis goinfré de musées, d'expos et d'églises !
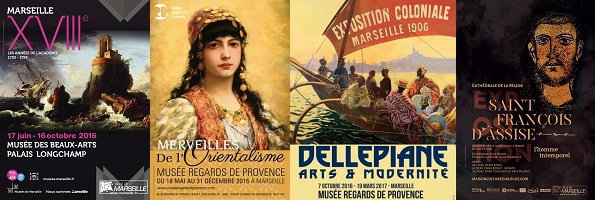
Au musée des BA, Marseille au XVIIIe siècle Les années de l'Académie 1753 – 1793 permet de découvrir la vie artistique dans la ville dans la deuxième moitié du XVIII°. Après une salle consacré à Michel Serre peintre baroque mort en 1733 qui sert à évoquer la grande peste de 1720 responsable du ralentissement de la vie culturelle locale pendant des années, on découvre une somptueuse série de marines de Joseph Vernet, dont le tableau sur le port de Marseille a influencé toute une génération d'artistes, et ses épigones. Excellente occasion de confirmer que Lacroix de Marseille, Henry d'Arles et le chevalier Volaire valent bien mieux que les petits tableautins médiocres que l'on trouve souvent sous leur nom.
On enchaîne avec des salles consacrées à l'académie de peinture et de sculpture de Marseille, avec des portraits de ses mécènes, des œuvres de son fondateur et directeur, Dandré-Bardon, qui mériterait bien une grande rétrospective, de certains de ses professeurs, de ses élèves ainsi que d'artistes qui y passait avant de se rendre en Italie (Vincent, Nattier fils, David...). Excellente occasion de découvrir ou d'en savoir plus sur des artistes moins connus (Forty, Bounieu, Fenouil, Julien de Toulon, Beaufort, Duparc...) grâce à un excellent choix d'œuvres. On aura aussi pu découvrir l'admirable série de Pierre Parrocel sur l'histoire de Tobie.
Le musée Regards de Provence présentait lui deux expositions temporaires. Merveilles de l'orientalisme présente 80 œuvres issues en grande majorité des collections de la Fondation et montre comment des artistes se sont confrontés pendant un siècle à ces territoires et à ces cultures. Les techniques utilisées sont très variés et tous les thèmes sont présents : portraits, paysages, scènes de genre, nus et même natures mortes ou scènes animalières. Si la plupart des très grands noms sont absents, on admire des artistes connus (Ziem, Loubon, Courdouan, Rochegrosse...) et d'autres un peu moins (très bel ensemble du marseillais Georges Washington, Crapelet, Chataud, Corrodi, Tetar van Elven...). Un seul regret : qu'aucun catalogue n'ait été édité.
Mais la révélation de ce court séjour à Marseille aura été pour moi la grande rétrospective consacrée à David Dellepiane. Arrivé jeune à Marseille avec ses parents italiens, il s'y formera à l'école des Beaux-Arts et naviguera, comme beaucoup d'artistes entre le XIX et le XX°, entre tradition et modernité. Si ses premières œuvres sont encore très marquées par l'académisme, on le verra par la suite touché par tous les nouveaux courants artistiques. Quelques paysages du sud-ouest et de l'Orient font penser aux Macchiaioli alors que ses superbes panneaux décoratifs, entre néo-impressionnisme et symbolisme, évoque autant Puvis de Chavannes qu'Henri Martin et ses magnifiques affiches l'Art Nouveau. On va avec ravissement de découvertes en découvertes, un peu surpris qu'il soit resté à la postérité pour ses représentations de santons, tardives dans sa carrière et pas forcément très intéressantes. Une rétrospective qui remet en tout cas en lumière, sans doute pas un artiste majeur, mais un très bon représentant de l'art entre ces deux siècles.
Enfin, la maison Culture & Dialogue propose dans le chœur de la cathédrale de La Major une exposition sur Saint François d'Assise. Si elle est plutôt intéressante de vue historique et iconographique, les œuvres présentées, pour une grande partie provenant de la collection Joseph Arakel, tiennent en grande majorité des arts et traditions populaires. On notera quand même quelques beaux tableaux dont une Vanités de Saint François d'Assise, attribuée à Peter Snyers et une Conversation sacrée de Lazzaro Baldi.
Marseille au XVIIIe siècle Les années de l'Académie 1753 – 1793, du 17 juin au 16 octobre 2016, musée des BA.
Merveilles de l'orientalisme, du 18 mai au 31 décembre 2016, musée Regards de Provence.
David Dellepiane, arts & modernité, du 7 octobre 2016 au 19 mars 2017, musée Regards de Provence.
Saint François d'Assise, l'homme intemporel, du 1er avril au 31 décembre, cathédrale de La Major.
15:06 Publié dans exposition en province | Lien permanent | Commentaires (0)

