19/05/2017
Au bord de la Seine...
Il y a une vingtaine de kilomètres et une région d'écart entre Vernon et Mantes mais la Seine lie les deux villes avec des activités nautiques qui ont été bouleversées depuis le XIX° siècle...
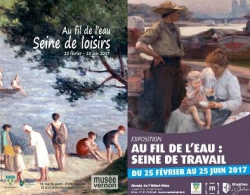
Du côté normand, le musée de Vernon présente un fleuve devenu espace de loisirs avec ses plages, ses guinguettes, son canotage... Assez petite en taille et en oeuvres exposées, l'exposition nous montre une Seine bucolique, avec ses baigneurs, ses pêcheurs, ses canots et ses voiliers. S'il y a peu de toiles marquantes (mais il y a eu beaucoup d'expo sur la Seine ces derniers temps donc il est sans doute difficile d'obtenir des prêts), on fait quelques jolies découvertes signées Léon Comerre, Ferdinand Heilbuth, Roger Jourdain (autoportrait en train de pêcher), Charles Bertrand d'Entraygues (l'amusant "Ca mort ?") et un bel ensemble du méconnu Gustave Maincent. Une exposition sympathique mais un peu décevante.
Au musée de Mantes on est accueilli par deux grands formats de Salon acclamés en leur temps qui annonce la couleur : les Lavandières d'Albert Dagneaux et les Bateliers de Paul-Michel Dupuy. La Seine va être le théâtre des travailleurs, haleurs, pêcheurs, laveuses, paysans... à travers une très belle série de toiles. Scènes de genre, hésitant entre naturalisme (Adler) et pittoresque (Meissonier fils) comme paysages de bords de Seine où apparaissent les usines et se multiplient les péniches par les peintres pré- comme post-impressionnistes (Boudin, Lebourg, Luce), nous montrent une France en pleine mutation. L'exposition est dense, complète et présente de charmants tableaux d'artistes un peu oubliés (Louis-Emile Minet, Victor Binet, Antoine Emile Plassan, Lucien Gros...) comme un bel ensemble d'oeuvres des écoles de Rouen. Elle est sans doute la plus réussie des nombreuses expositions consacrées au fleuve ces dernières années...
Au fil de l'eau, Seine de loisirs, musée de Vernon, jusqu'au 25 juin 2017.
Au fil de l'eau : Seine de travail, musée de l'Hôtel-Dieu, Mantes, jusqu'au 25 juin
10:02 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
14/07/2016
Un printemps 2016... en banlieue parisienne !
Il n'y a pas qu'à Paris que se sont multipliées les expositions ce printemps, il y en avait également plein en banlieue, et la plupart sont encore ouvertes une bonne partie de l'été, alors on y va...
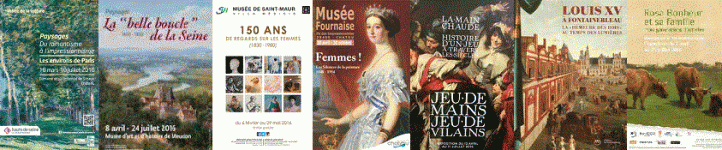
Si le titre pouvait faire craindre une exposition racoleuse (encore les impressionnistes!), le musée de Sceaux présente en fait une petite histoire (bien entendue très incomplète) de la peintre du paysage au XIX°. On y trouve ainsi les précurseurs de la peinture en plein air (Georges Michel, Lazare Bruandet, Paul Huet), influencés par les paysagistes hollandais (un beau Ruysdael est là pour constater cette influence) puis les différentes générations suivantes comme l'école de Barbizon (Rousseau, Corot, Daubigny ) ou les impressionnistes sont, en fait peu présents (un beau Renoir, deux Sisley, un Lebourg). Le choix des œuvres est plutôt bon et on découvre en autres de très belles toiles d'Eugene Lavieille (Barbizon sous la neige) ou Pierre-Emmanuel Damoye (La Seine à Nanterre). Et si près de la moitié des œuvres proviennent du musée, un certain nombre sortent des réserves (Antoine Drulin, Jean-Jacques Champin...).
Paysages. Du romantisme à l'impressionnisme. Les environs de Paris, musée du domaine départemental de Sceaux, jusqu'au 10 juillet 2016.
Encore des paysages avec l'exposition à Meudon sur la belle boucle de la seine qui présente en une quarantaine d’œuvres (gravures, aquarelles, toiles) des motifs très différents pris pourtant dans des lieux proches et qui laissent songeur sur les transformations de la région. On y trouve des œuvres encore classiques (Dunouy, Ricois) ou plus modernes (Ziem), des artistes connus (Huet, Troyon) comme des petits maîtres plus méconnus (Langlacé, Isidore-Laurent Deroy, André Jolivard) ou inconnus comme A. Regnier. Si l'exposition est un peu courte, on regrettera surtout que de nombreuses œuvres viennent de Meudon et de Sceaux, ce qui limite les découvertes.
La Belle Boucle de la Seine (1800- 1860), musée d'art et d'histoire de Meudon, jusqu'au 24 juillet 2016.
Le musée de St Maur organise une présentation de ses collections sur le thème de la femme en différentes sections (portraits intimes, officiels, travail...) parmi lesquelles on remarque un beau Grande marée dans la Manche d'August Hagborg, quelques bons portraits de Edmond Quinton, Edouard Bisson, Madeleine Carpentier et surtout un superbe ensemble de portraits et de scènes de genre de Victor Lecomte dont le musée a récupéré le fond d'atelier et qui était un spécialiste des scènes en éclairage artificiel. Un musée qui mérite qu'on le découvre.
150 ans de regards sur les femmes, Musée Villa Médicis de Saint-Maur, jusqu'au 6 novembre 2016.
Autre exposition sur la femme, celle-ci à Chatou avec une trentaine d’œuvres venues de différents musées français souvent méconnus. Dans des thèmes assez imilares à la précédentes, on trouve peu d'artistes célèbres (seuls Debat Ponsan, Corolus Durand et Béraud sont encore reconnus aujourd'hui, certains sont vraiment très méconnus) mais les petits maîtres oubliés du XIX° présentés sont capables de charmer ou d'attendrir et au final on en prendrait bien un peu plus que la trentaine d'œuvres présentes... A noter que le catalogue est téléchargeable gratuitement sur le site du musée.
Femmes, les silences de la peinture, musée Fournaise, Chatou, jusqu'au 30 octobre 2016.
Petite mais passionnante exposition à Courbevoie autour du Jeu de la main chaude de Ferdinand Roybet. Outre des études pour ce grand et magnifique tableau, accompagnées de quelques autres œuvres du maître sur le thème du jeu, on trouve de nombreux documents (ivoires, illustrations...) sur 7 siècles d'histoire d'un jeu disparu brutalement après la deuxième guerre mondiale dont quelques très bonnes peintures de Antoinette Cécile Hortense Haudebourg-Lescot, Louis Léopold Boilly ou Hieronymus Janssens. Comme en plus le catalogue est pas cher et très intéressant...
Jeu de mains, jeu de vilains, musée Roybet Fould, Courbevoie, jusqu'au 11 juillet 2016.
Si l'exposition sur Louis XV à Fontainebleau présente finalement peu de tableaux (et la plupart sont bien connus) pour faire la part belle à des plans, maquettes, éléments de décoration, meubles... elle est aussi l'occasion de découvrir les appartements des chasses habituellement fermés (en tout cas pour les visites libres) avec ses natures mortes (Oudry, Desportes, Bachelier... notons qu'il est très désagréable à Fontainebleau de n'avoir que très peu d'informations dans les salles) et surtout les cartons pour les chasses de Louis XV par Oudry. Rien que ça vaut le détour.
Louis XV à Fontainebleau, château de Fontainebleau, jusqu'au 11 juillet 2016.
Si le musée de Port-Royal n'a pas les moyens (surtout en place...) d'organiser une grande rétrospective comme celle qui a eu lieu en 96/97 à Bordeaux et Barbizon, son choix de ne pas présenter seulement Rosa Bonheur mais aussi son influence principale Jacques Raymond Brascassat (dont il est incompréhensible que les œuvres ne soient en général pas présentées au Louvre), ses frères et les proches de la famille (Eugène Carrière). Rosa est ainsi présentes essentiellement par des petits tableaux et des esquisses souvent en mains privées, mais aussi des sculptures et on découvre le talent des autres membres de la famille, eux aussi dans le paysage et la représentation animalière. Une exposition qui vaut le détour...
Rosa Bonheur et sa famille, trois générations d'artistes, musée national de Port-Royal des Champs, jusqu'au 25 juillet 2016.
22:43 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
10/12/2014
Allez à Meudon !
Merci à La Tribune de l'Art d'avoir consacré un article à l'exposition Jean Laronze (1852 - 1937 ). Sans cela, je l'aurais sans doute loupée, le musée d'Art et d'Histoire de Meudon ayant tendance à bien trop peu médiatiser ses expos, pourtant souvent excellentes (il y a eu Théodore Rousseau l'an dernier par exemple).

Je ne connaissais Laronze essentiellement qu'à travers les illustrations du catalogue de l'exposition Paysages de Bourgogne ayant eu lieu à Dijon en 2001-2002. La trentaine d'œuvres présentées m'a fait découvrir un artiste sensible et délicat, créant à travers une lumière douce, souvent du soir, des ambiances particulièrement sereines sur des paysages calmes où l'être humain ne joue, au mieux, qu'un rôle accessoire, et cela aussi bien dans ses représentation du bord de Loire, qu'il adorait, que de la côte du Nord, où il dut se rendre en raison de la santé de son fils.
Aussi à l'aise sur toile que sur papier (quelques grands dessins au fusain et à la craie sont vraiment superbes), il digère ses influences de Barbizon au Symbolisme pour créer des scènes d'une telle quiétude qu'elles paraissent idylliques. Au final, si l'exposition du musée de Meudon mérite amplement le détour et permet de redécouvrir bien plus qu'un "petit maître", on regrette un peu qu'une partie de son œuvre ne soit pas représentée (les paysages avec bergères comme La gardeuse de moutons du musée de Dijon ou La Marguerite du musée de Charolles) et que des toiles comme Le Soir, Charolais (Mâcon), L'angélus (Mâcon) ou Pêcheurs charolais (Dijon) ne soient pas présentes. Sans parler des œuvres apparemment vendues outre-Atlantique...
Comme tant d'autres, Laronze mériterait une vraie grande rétrospective, mais ce n'est sans doute par pour demain, alors il faut se dépêcher d'aller à Meudon...
Jean Laronze, rives et rivages, musée d’Art et d’Histoire de Meudon, jusqu'au 15 décembre 2014.
19:02 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
30/11/2014
Portrait de l'époque romantique
Je ne connaissais pas le lieu, et il est tout à fait charmant. Quoi de mieux en effet qu'un vieil intérieur bourgeois au milieu des bois pour exposer plus d'une centaine de portraits de la première moitié du XIX° dans toute leur diversité (miniature, dessin ou peinture ; intime ou officiel) ?
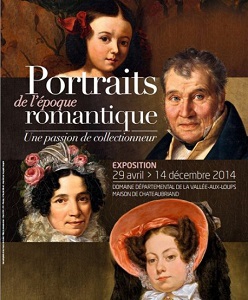
Alors que dans les musées on s'habitue à ne voir que les grands maîtres et que dans les châteaux les portraits font en quelque sorte partie des meubles, cette présentation, qui va d'œuvres anonymes parfois maladroites à d'autres de maîtres reconnus (Winterhalter, Devéria, Dubufe, Hersent, Isabey...), permet de mieux appréhender un genre dont le but restait de garder ou de perpétuer le souvenir. Et s'il y a du coup beaucoup de petites choses anecdotiques, il est néanmoins passionnant de découvrir toutes les variations dans les poses, les décors, les expressions, les costumes...
Portrait de l'époque romantique, une passion de collectionneur. Maison de Chateaubriand, Chatenay-Malabry jusqu'au 15 décembre
17:53 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
31/10/2014
L'enfant vu par les peintres du XIX° siècle
Il ne reste que trois jours aux amateurs de peintures de la deuxième moitié du XIX° siècle pour se rendre à Chatou admirer une quarantaine d'œuvres sur le thème de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'enterrement. On y trouve une grande variété de thèmes, dont l'enfant peut-être le sujet principal ou un détail de la composition, comme une grande variété d'ambiances, du misérabilisme des enfants des rues de Pelez à la douceur familiale du foyer Dantan.
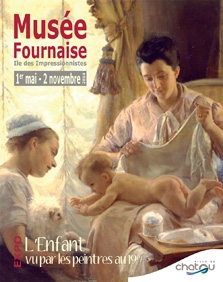
Mais c'est surtout l'occasion de retrouver (Pelez ou Dantan ont eu droit récemment à une exposition monographique, Géo à un très beau livre) et de découvrir certains petits maîtres injustement qualifiés d'académiques voire de pompiers, et de constater encore une fois à quels points leurs ambitions comme leurs styles (du néo-classicisme de Sauvage à l'impressionnisme sage de Henri Michel Levy en passant -entre autres- par le naturalisme ou l'imitation des maîtres anciens) peuvent être différents. Mes tableaux préférés auront sans doute été le lumineux La femme du jardinier de Saintin que je ne connaissais que par ses paysages, Le retour du marché de Léon Albert Hayon et le saisissant L'ivrogne de Gustave Edme Brun mais toutes les œuvres présentées méritent d'être vues.
Une exposition très intéressante même si on l'aurait préférée plus dense (quid des thèmes de l'école et de la lecture ?) et dont le seul défaut est d'avoir un catalogue bien maigre avec quelques photos médiocres, des notices bien maigres (quand elles existent) sur les auteurs, une bibliographie rachitique et un essai d'introduction qui nous explique essentiellement que tout reste à faire sur le sujet. Souhaitons que quelqu'un le fasse, le thème de l'enfant le mérite largement.
L'enfant vu par les peintres du XIX° siècle, musée Fournaise, Chatou, jusqu'au 2 novembre 2014.
10:33 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
15/08/2014
Vite ça ferme aussi !
Je ne savais pas du tout qu'il y avait un musée à Courbevoie, et encore moins qu'il était en partie consacré à Ferdinand Roybet, maître reconnu de la fin du XIX°, surtout connu aujourd'hui pour ses scènes de genre historique, en particulier de "mousquetaires". La découverte dans le Pariscope d'une expo baptisée Femmes et artistes au XIXe siècle, m'incite donc à aller le découvrir.
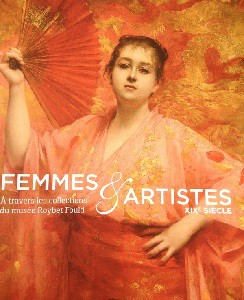
Organisée autour de quatre femmes, Valérie Simonin, plus connue sous le pseudonyme de Gustave Haller, qui fut comédienne, trois fois mariées, sculpteur, écrivain et critique d'art, ses filles Consuelo Fould et Georges Achille-Fould ainsi que l'italienne Juana Romani qui commença comme modèle pour Falguière, Carolus Duran, Henner..., l'exposition présente leur vie, parfois très romanesque, et leurs œuvres mais aussi celles de leur cercle ou de leurs maîtres, essentiellement tirées des collections du musée mais pas uniquement.
Et si elles ont toutes tendance à rester dans un académisme des plus classiques, elles le font avec un certain talent et non sans faire preuve de ce qu'on pourrait facilement taxer de nos jours de féminisme. Difficile de rester insensible aux scènes historiques légèrement symbolistes de Consuelo Fould (Les druidesses apaisant la tempête, Sur les ailes du rêve), aux portraits de sa sœur Georges Achille-Fould (La chauffeuse de tramway, Lydie Rodrigues Henriques en mariée) et de Juana Romani (Portrait de femme en costume vénitien, Portrait de jeune fille) et le seul regret que l'on a finalement en sortant (comme pour beaucoup d'expositions consacrées à ces peintres un peu oubliés des Salons de la fin XX° / début XX°), c'est qu'il n'y ait pas beaucoup plus d'œuvres...
Femmes et artistes au XIXe siècle, du 17 mai au 18 août, musée Roybet Fould, Courbevoie.
15:46 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
27/04/2013
C'est pas d'la faute à Rousseau
Hey, les parisiens ! Vous ne savez pas quoi faire ce weekend ? Pourquoi pas prendre le RER pour se rendre à Meudon profiter des derniers jours d'ouverture de la petite rétrospective consacrée à Théodore Rousseau ?
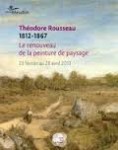
Présent sur les cimaises de tous les musées français et à toutes les expositions consacrées au paysage français au XIX° siècle, figure emblématique de l'école de Barbizon (où il est d'ailleurs mort) mais cité en général après Corot et Millet, longtemps refusé aux Salons, Théodore Rousseau ( 1812 - 1867 ) est sans doute un "grand nom", mais qui reste trop méconnu. Pour preuve, l'expo que lui consacre le musée de Meudon est la première en France depuis celle du Louvre en 1967 (pourtant le bicentenaire de sa naissance aurait été une belle occasion). Et si elle est fort intéressante, elle ne peut avoir ni l'impact ni la dimension que celle qu'aurait pu (du ?) lui consacrer une grande institution.
En ouvrant l'exposition sur un très beau Paysage aux deux chênes de Salomon van Ruysdael tout en présentant des petits formats / esquisses de ses premières années pris sur le vif dans différentes régions françaises, on découvre parfaitement une oeuvre placée entre l'admiration des anciens (les hollandais mais aussi Poussin ou le Lorrain) et l'observation de la nature. Que ce soit dans ses toiles les plus finies (trois superbes paysages du musée d'Orsay et un de Reims) comme dans ses oeuvres à la touche plus libres ou dans ses dessins, il fait preuve d'un admirable sens et d'un grand amour de cette nature belle et sauvage.
Et si on ne peut que regretter que le taille (une quarantaine d'oeuvres seulement) de l'exposition, elle s'intègre parfaitement aux collections permanentes, qui présentent 100 ans de paysages français sous tous ses aspects, de l'artiste oublié aux grands noms.
Théodore Rousseau (1812-1867), le renouveau de la peinture de paysage, Meudon, Musée d'art et d'histoire, du samedi 23 février 2013 au dimanche 28 avril 2013.
14:25 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)

