22/09/2019
Un été parisien 2019 VI-orsay
Si vous avez envie d'une sortie bien copieuse et bondée pour les journées du patrimoine et que vous n'avez pas encore fait l'exposition Morisot... bein bon courage !
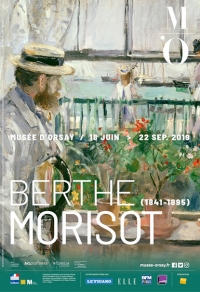
En effet, les salles du premier étage qui abrite l'exposition (et seront semble-t-il désormais consacrées à ça) sont assez petites et peu adaptées à une foule nombreuse. En août ça restait supportable même si le confort de visite était moyen, mais en début de semaine c'était l'enfer alors je n'imagine même pas le dernier jour... Bousculades et engueulades seront sans doute au rendez-vous ! S'il est logique d'avoir mis Sérusier, Gauguin et Van Gogh au 5ème étage à la suite des Impressionnistes, ces salles étaient, me semble-t-il, bien plus adaptées aux expositions temporaires qu'elles ont abritées pendant des années.
La rétrospective Berthe Morisot est en revanche une grande réussite. Bien construite, plus riche en œuvres majeures que celle du musée Marmottan il y a quelques années (même s'il y a pas mal de peintures en commun), elle donne une vision très complète d'une artiste que j'avais du mal (à tord donc) à mettre aux premiers rangs de l'impressionnisme. Et pour compléter la visite, il faut absolument aller voir les pastels de Mary Cassatt exposés au 5ème étage ainsi que les dessins de Morisot, Cassatt, Bracquemond... exposées au rez-de-chaussé...
Berthe Morisot (1841 - 1895 ), Paris, musée d'Orsay, jusqu'au 22 septembre 2019.
10:41 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)
Un été parisien 2019 V - Courbevoie
Si vous avez envie d'une petite sortie pas trop copieuse pour les journées du patrimoine, un petit saut au musée Roybet-Fould s'impose ! Vous pourrez profiter des œuvres de Ferdinand Roybet, George Achille-Fould et Consuelo Fould dans un accrochage qui profite de l'ouverture d'une nouvelle salle au première étage ainsi que de la petite exposition-dossier consacrée à l'enfance dans les collections du musée.

S'il y a peu d’œuvres présentées dans deux petites salles, c'est l'occasion de découvrir des dessins et peintures habituellement dans les réserves comme le somptueux Portrait de Melle Bramme (qui sert d'affiche) de Roybet également représenté (entre autres) par La fillette à la poupée et Jeune page en grisaille. On notera aussi La poupée cassée de Louis Antoine Capdevielle et la Jeune fille à la poupée de Gustave Poetzsch. Plein de bonnes raisons de se rendre dans ce musée petit mais très actif...
L'enfance dans l'art, opus II, Courbevoie, musée Roybet-Fould, jusqu'au 22 septembre
10:18 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
15/09/2019
Un été parisien 2019 IV - Petit Palais
Si vous avez raté (quelle erreur !) au Petit Palais la sublime exposition sur les dessins allemands du musée de Weimar, occasion unique de découvrir un ensemble exceptionnel d'œuvres de Füssli, Friedrich, des Nazaréens..., il est encore temps de courir aujourd'hui y voir Paris romantique.
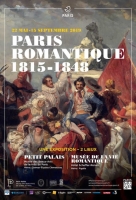
Et si vous n'aimez pas le romantisme (quelle erreur !), sachez que ce n'est pas tant le sujet de cette exposition (même si bien évidemment tous les grands artistes, peintres, sculpteurs, écrivains, musiciens... du mouvement sont évoqués) que la vie à Paris à l'époque romantique sous tous ses aspects. On découvre donc à travers les salles les goûts des souverains comme des élégants de cette période 1815-1848 à travers une foultitude d'objets divers (costumes, accessoires de mode, vaisselle, mobilier, dessins, peintures, sculptures ...) et il est difficile de ne pas se perdre tellement cela foisonne de partout.
Au milieu de tout ça, la salle consacrée au Salon avec son accrochage dense et serré est un ravissement. Entre les œuvres pas forcément très connues d'artistes majeurs (Géricault, Delacroix, Gérard, Girodet) et des œuvres majeures d'artistes aujourd'hui moins célèbres (gros coup de cœur pour 'Un rayon de soleil' de Célestin Nanteuil, 'Un gypaète dévorant sa proie de Jules Coignet et le 'Réveil du juste, réveil du méchant' d'Emile Signol). On notera aussi un grand nombre de portraits de qualité dont on ressortira deux superbes portraits de femme par Joseph Désiré Court.
Ca ferme, il faut y courir, ainsi qu'au musée de la Vie Romantique qui abrite la partie de l'exposition consacrée au salons littéraires.
Paris romantique, 1815-1848, Paris, Petit Palais, jusqu'au 15 septembre 2019.
09:48 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)
15/08/2019
Un été parisien 2019 III - Auvers sur Oise
Ne venez pas à Auvers pour voir une rétrospective Corot contrairement à ce que le titre pourrait vous laisser penser. Il n'y a que 12 toiles du grand maître dont 10 proviennent du musée de Reims toujours en travaux et les deux autres de collections privées (dont une n'est qu'attribuée à). En revanche venez voir un très beau panorama de la peinture de paysage de cette époque avec les maîtres, les contemporains, les élèves et les imitateurs de Corot.
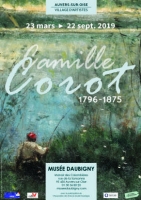
N'espérez par ailleurs pas trop d'explications. Après une salle d'introduction exposant le Portrait de Corot par Dutilleux et deux œuvres de ses maîtres Bertin et Michallon (représenté par le superbe Moulin de la cave venant lui aussi de Reims), la grande salle suivante nous parle de Corot en Italie mais présente entre autres un paysage de Fontainebleau. Et si la suivante nous parle de Corot voyageur, difficile de trouver la moindre cohérence dans les œuvres présentées. Les trois dernières salles sont dénuées de panneau explicatif mais semblent avoir pour thème Corot et la gravure, l'école d'Arras et les imitateurs du maître.
je peux paraitre critique mais j'ai beaucoup aimé l'exposition, je regrette juste que si on en prend plein les yeux, on n'y apprend pas grand chose... Outre les Corot de Reims, tous très beaux (mention spéciale au sublime Mantes (le matin)), une petite liste des œuvres que j'ai préféré presque toutes provenant de collections privées :
- Bord de mer en Italie et Villa et moulin au bord de Méditerrannée de François Louis Français, très différents de ses habituels sous-bois,
- Le repos du jeune garçon et Neige à Barbizon d'Eugène Lavieille,
- La récolte, les champs de pomme de terre, d'Antoine Chintreuil
- Vue de Rome et Les chênes de Brascassat qui rappellent que le grand peintre animalier a été formé comme paysagiste,
- Le passage du bac de Louis Aimé Japy,
- Crépuscule de Louis Alexandre Bouché qui adapte la technique du maître à une lumière nocturne,
- Paysage à la mare avec bergère et moutons de la peu connue Marie Brodbeck qui fut élève du maître.
Camille Corot (1796-1875), Auvers sur Oise, musée Daubigny jusqu'au 22 septembre 2019
09:44 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)
12/08/2019
Un été parisien 2019 II - Fondation Custodia
L'exposition Frans Hals a la fondation Custodia n'est certes pas une rétrospective mais elle est néanmoins indispensable. En effet cinq de ses portraits de famille ont été rassemblés (dont les trois fragments de La famille van Campen dont une vidéo explique comment on a reconstitué le "puzzle") et c'est un immense plaisir de pouvoir naviguer de l'un à l'autre (et facilement, il n'y a pas grand monde), comparer les compositions, les interactions, la manière. Si Hals est un immense portraitiste brossant brillamment les visages comme les costumes, on découvre sa façon de mettre en scène les rapports familiaux. Si on ne peut comparer les toiles du maîtres avec celles de ces contemporains, on peut en revanche voir sur des dessins d'Abraham van Diepenbeeck et Adriaen van Ostade de la fondation Custodia d'autres façons d'envisager ce genre de représentation.
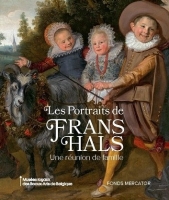
L'autre partie de l'exposition présente en effet les peintures et œuvres sur papier du siècle d'or appartenant à la Fondation et représentant des enfants, du bébé à l'adolescent. Du portrait officiel (Portrait de Cornelis van Groenendyck par Abraham van den Tempel) au plus intime (Willem Paets dans son berceau par Frans van Mieris l’Ancien) en passant par l'enfant qui joue (Un enfant jouant du tambour à friction par Adriaen van der Werff), les représentations sont très variées. Coups de cœur pour ma part pour des dessins : le superbe Femme portant un enfant sur ses genoux de Rembrandt, l'Étude de tête de fillette de Cornelis de Vos ou l'Enfant endormi de Govert Flinck ainsi que pour l'étonnant tableau Trois jeunes gens, l’un dessinant attribué avec réserves à Jacob van Oost l’Ancien, mais il y a vraiment énormément de belles choses dans la quarantaine d’œuvres présentées. Et pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, le catalogue est consultable en ligne.
Frans Hals, portrait de famille & Enfants du siècle d'or, Paris, Fondation Custodia, jusqu'au 25 août.
18:40 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)
11/08/2019
Un été parisien 2019 I - quai Branly
Cette exposition ne correspond pas vraiment au propos habituel de cet humble blog et je ne parlerai pas du très beau rassemblement d'œuvres d'art africaines et océaniennes provenant de l'ancienne collection Fénéon extrêmement réputée à l'époque.
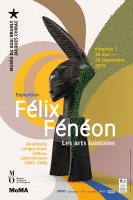
Mais outre le fait qu'elle permet de bien comprendre qui était Félix Fénéon, anarchiste, écrivain et critique d'art (et d'avoir hâte de découvrir la suite de l'expo a l'orangerie) elle était l'occasion de voir ou revoir des œuvres de Lucie Cousturier artiste néo-impressionniste découverte l'an dernier à Vernon.
Représentée par une seule (très belle) peinture sans rapport avec le thème (Femme à la langouste), on admire en revanche une dizaine de dessins et d'aquarelles d'Afrique ou d'africains (dont certains n'étaient d'ailleurs pas à Vernon) ou l'on retrouve ces couleurs et cette sensibilité particulières.

Parmi les rares autres peintures, on notera le Portrait de Fénéon par Maximilien Luce et trois études de nu de Georges Seurat du musée d'Orsay et un très beau Nu debout de Théo van Rysselberghe. Une exposition passionnante pour en savoir plus sur ce singulier personnage.
Félix Fénéon (1861-1944), Paris, musée du Quai Branly, jusqu'au 29 septembre 2019.
12:42 Publié dans exposition à Paris | Lien permanent | Commentaires (0)
29/07/2018
Un printemps en région parisienne 2018 VIII - la porte des rêves
Puisque l'exposition ferme aujourd'hui (vous pouvez y courir), je vais conclure rapidement la série consacrée aux expositions du printemps par quelques mots sur la collection privée d'œuvres symbolistes présentées sous le titre de La Porte des Rêves à la propriété Caillebotte à Yerres. Le manque de temps et de motivation m'auront souvent fait écrire bien trop tard, voire pas du tout comme pour la très belle expo Luce à Louviers ou la très réussie Napoléon stratège aux Invalides.

Si l'on en saura guère plus sur ce qui définit le symbolisme et permet de ranger une œuvre sous ce nom (la présence d'une toile de Gervex reste surprenante par exemple) tout au long des 160 et quelques peintures, sculptures, pastels, dessins, gravures..., c'est un immense plaisir de découvrir de très beaux ensembles d'artistes bien qu'on connait déjà bien comme Schwabe, Levy-Dhurmer, Séon (on se souvient avoir vu certaines de ces œuvres à la très belle rétrospective que lui avait consacré le musée de Quimper), Maxence, Martin, Ménard, Osbert ou peu comme Lacoste, Guilloux, de Groux, Fabry, Chabas ou Armand Point. Et de tomber sur quelques noms qu'on ne connait absolument par comme l'américaine Romaine Brooks dont le Printemps ouvre l'exposition et a été utilisé pour l'affiche, la, semble-t-il très rare, Jeanne Jacquemin avec La douloureuse et glorieuse couronne ou Hélie Brasilier et son Adam et Eve. Un ensemble assez extraordinaire...
La porte des rêves – Un regard symboliste, Yerres, Propriété Caillebotte, jusqu'au 29 juillet 2018
14:56 Publié dans exposition en région parisienne | Lien permanent | Commentaires (0)

